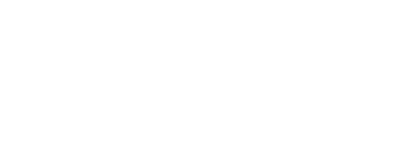22 septembre 2018 — Une jeune fille a pu garder son chat à des fins de zoothérapie, chez elle, même si la présence d’animaux est interdite dans l’immeuble où elle habite. Cette histoire s’inscrit dans une série d’autres jugements passés, qui ont démontré que l’engagement contractuel, au moyen d’un bail, ne fait pas toujours foi de tout.
La Régie du logement avait d’abord donné raison au locateur dans ce dossier, mais la Cour du Québec est venue casser cette décision. L’histoire dont il est question s’est déroulée à Chicoutimi (J. L. c. Coopérative L’Ébène), il y a près de 20 ans.
Lorsqu’elle signe un bail annuel en avril 1999, la mère de l’enfant sait qu’elle ne pourra pas avoir d’animal dans son appartement. Le bail stipule que « Les animaux ne sont pas tolérés dans l’immeuble, sauf les oiseaux en cage et les poissons. Aucun animal ne sera toléré dans les lieux loués, à moins que le locataire ait obtenu l’autorisation écrite du locateur. »
Mais trois ans plus tard, l’enfant présente des troubles de comportement à la maison, si bien qu’il est suivi par une psychologue scolaire. Cette dernière décèle un « problème d’anxiété », teinté d’une insécurité, en raison d’une crainte de perdre sa mère. Le jugement précise qu’elle avait même envie de mourir, d’où la demande de consultation d’une psychologue.
Par conséquent, l’enfant garde un animal depuis mars 2003, à la suggestion de la psychologue, qui traite la jeune fille au moyen de la zoothérapie. Dans un rapport complémentaire, elle écrit : « L’enfant est suivie en psychologie à l’école pour des crises de colère à la maison. Sa mère m’a signalé que la présence d’un chat, au foyer, lui apportait du réconfort. » Ainsi, la jeune fille apprend à s’occuper d’un animal, à être responsable et à avoir du respect envers « plus petit que soi. ». La présence du chat lui apporte « à la fois apaisement et relaxation. »
Traitement respectueux
Dans sa décision, la Régie précise que l’animal est notamment castré et traité « aux petits oignons », que ce soit par la fille ou sa mère. Il est également vacciné. Mais lorsque le conseil d’administration de la coopérative apprend qu’un chat habite dans cette unité, il envoie une mise en demeure à la mère pour l’enjoindre à s’en débarrasser. La locataire plaidera, par l’entremise de son avocat, que la présence du chat est requise, étant donné la condition de santé de sa fille. Elle demande donc une dérogation à la règle générale, vu les circonstances particulières du présent cas. Autrement, la clause pourrait être jugée abusive au sens de l’article 1901 du Code civil du Québec, décrit le jugement.
 L’avocat joint à sa lettre envoyée au CA un certificat médical du pédopsychiatre Marc-Yves Leclerc, qui confirme que l’enfant a besoin d’un chat, en raison d’un trouble anxieux. Qu’à cela ne tienne, après une seconde demande de dérogation au CA, le locateur ne bronche pas, annonçant que la Coopérative de l’Ébène « maintient sa décision quant à l’expulsion du chat. » Il ajoute que plusieurs nouveaux arrivants dans cette coopérative en avaient un, eux aussi, mais qu’ils ont dû s’en départir. Le locateur craint, aussi, que la présence d’un animal dans ce logement fasse « boule de neige », et que d’autres enfants désirent également avoir un chat.
L’avocat joint à sa lettre envoyée au CA un certificat médical du pédopsychiatre Marc-Yves Leclerc, qui confirme que l’enfant a besoin d’un chat, en raison d’un trouble anxieux. Qu’à cela ne tienne, après une seconde demande de dérogation au CA, le locateur ne bronche pas, annonçant que la Coopérative de l’Ébène « maintient sa décision quant à l’expulsion du chat. » Il ajoute que plusieurs nouveaux arrivants dans cette coopérative en avaient un, eux aussi, mais qu’ils ont dû s’en départir. Le locateur craint, aussi, que la présence d’un animal dans ce logement fasse « boule de neige », et que d’autres enfants désirent également avoir un chat.
La locataire persiste et signe
« Ce sont de beaux et grands logements qui exigent beaucoup d’entretien. S’il fallait en plus surveiller l’urine des chats… Pour toutes ces raisons, Madame doit se départir de son chat dans les meilleurs délais », conclut le locateur. Par la suite, le CA convoque la locataire à une rencontre, mais cette dernière ne s’y présente pas, car elle entend conserver l’animal. Le locateur intente alors un recours à la Régie du logement. Il demande que la locataire s’en départisse ou résilie son bail.
Dans l’intervalle, le Dr Leclerc envoie un nouveau rapport à la mère, attestant que sa fille présente un trouble d’anxiété de séparation, un trouble d’opposition ainsi qu’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. « L’anxiété de séparation occupe une place importante dans la vie de la jeune patiente, qui a amené à ce que soit utilisée pour lutter contre celle-ci d’une part la zoothérapie », dit-il, ajoutant que la jeune fille a désormais un chat auquel elle est très attachée. L’animal lui a « clairement » permis « d’acquérir beaucoup plus d’autonomie par rapport à la mère, et par rapport à la maison. »
 La jeune fille a besoin du chat
La jeune fille a besoin du chat
« Ce travail avec le chat doit pouvoir se continuer, et il reste également tout à fait indispensable », détaille le Dr Leclerc. Cette relation qu’elle a développée avec l’animal est d’une « extrême importance. » De plus, la patiente doit pouvoir rester dans l’appartement où elle vit, car s’il y avait « rupture de lieu, cela entraînerait, à nouveau, les manifestations de type anxiété de séparation, selon toute vraisemblance. »
Le 21 avril 2004, la Cour du Québec autorise l’appel et retient les sept questions proposées par la locataire. Parmi elles, il lui faut se demander si l’affirmation du régisseur (la Régie), qui a dit que la zoothérapie n’était possible que dans les logements où il est permis d’avoir un animal, constitue une faiblesse apparente de sa décision et au surplus, une erreur de droit affectant les conclusions de sa décision. Il a également dû s’interroger sur le fait que la Régie a possiblement erré dans son interprétation de la preuve, plus spécifiquement lorsqu’elle a écarté, sans raison, le témoignage non contredit d’experts.
La Régie du logement a-t-elle eu raison?
En somme, la décision de la Régie a-t-elle tenu compte de tous les éléments apportés en preuve? De même, est-ce que la clause interdisant les animaux est abusive dans les circonstances et, le cas échéant, quel est le remède applicable? La Cour du Québec a bel et bien reconnu qu’une clause interdisant les animaux dans un logement locatif « n’est pas en soi abusive. Toutefois, la situation se corse lorsqu’un locataire soulève la défense de zoothérapie, soit l’activité “impliquant l’utilisation d’un animal auprès de personnes, dans un but récréatif ou clinique. Cette méthode favorise les liens naturels et bienfaisants existant entre les humains et les animaux, à des fins préventives et thérapeutiques.”
 L’avocat émérite (Ad. E.) en droit immobilier, Yves Papineau, fait savoir qu’en matière de logement locatif, l’interdiction d’avoir un animal est en principe valide. “Toutefois, elle est susceptible d’être sujette à une exception, que les tribunaux ont abordée sous l’angle de la clause abusive (article 1901 du Code civil du Québec)”, soulève-t-il. Sur cette question, le jugement Demers c. Rabouin a été maintes fois repris par la Cour du Québec. Il se résume ainsi : “Une clause interdisant la garde d’animaux sera valide et non abusive, sauf si preuve est faite que l’animal ne cause aucun trouble au sein de l’immeuble, et que sa présence est nécessaire pour la santé ou la sécurité du locataire, preuve médicale à l’appui.”
L’avocat émérite (Ad. E.) en droit immobilier, Yves Papineau, fait savoir qu’en matière de logement locatif, l’interdiction d’avoir un animal est en principe valide. “Toutefois, elle est susceptible d’être sujette à une exception, que les tribunaux ont abordée sous l’angle de la clause abusive (article 1901 du Code civil du Québec)”, soulève-t-il. Sur cette question, le jugement Demers c. Rabouin a été maintes fois repris par la Cour du Québec. Il se résume ainsi : “Une clause interdisant la garde d’animaux sera valide et non abusive, sauf si preuve est faite que l’animal ne cause aucun trouble au sein de l’immeuble, et que sa présence est nécessaire pour la santé ou la sécurité du locataire, preuve médicale à l’appui.”
Un chat n’est pas un molosse
Le Tribunal estime qu’il faut faire la différence “entre un chat qui ne sort jamais de l’appartement de son maître, et un molosse pesant 35 kilos qui hanterait les espaces communs.” Par conséquent, il a conclu que l’application de la clause, dans les circonstances actuelles, était déraisonnable. Priver l’enfant de l’animal équivalait à le priver de soins et dépassait la mesure. La clause d’interdiction a donc été déclarée abusive au sens de l’article 1901. Dans les circonstance, le Tribunal a donc réduit la portée de la clause, en suspendant son effet pendant la durée du traitement en zoothérapie.
Cette décision s’est appuyée sur divers arguments, notamment parce que la preuve n’a pas révélé que la présence du chat était problématique. Le juge a également pris en compte les rapports écrits par la psychologue scolaire Constance Marchand, ainsi que par le pédopsychiatre Marc-Yves Leclerc, qui ont témoigné que l’animal était nécessaire à la santé de l’enfant. Or, le témoignage d’experts “non contredit ne peut être écarté arbitrairement et doit généralement être accepté.”
 Droit d’inspection du bien loué
Droit d’inspection du bien loué
En revanche, le juge a ajouté qu’en vertu de l’article 1857 du Code civil du Québec, le locateur peut procéder à une inspection raisonnable du bien loué. En outre, l’article 1862 prévoit que le locataire, en certaines situations, peut être tenu de réparer le préjudice subi par le locateur, en raison des pertes survenues dans l’appartement.
En somme, pour reprendre un argument exprimé par la Cour suprême dans l’arrêt Syndicat Northcrest c. Amselem : “Aucun droit n’est absolu, et il faut rechercher l’équilibre entre les intérêts divergents.” Ces observations, prononcées dans un contexte différent, ne constituent pas l’assise du présent jugement. “Elles ont toutefois le mérite de rappeler que dans une société, il faut faire preuve de tolérance et tenter de concilier les droits des uns et des autres”, a conclu le Tribunal.
Ce texte a été validé par le cabinet Papineau Avocats Inc.
Photo 3-4-5: AIINIkArt; Engin_Akyurt; JensEnemark.
Vous aimez cet article? Aimez-nous sur Facebook.
Tous droits réservés